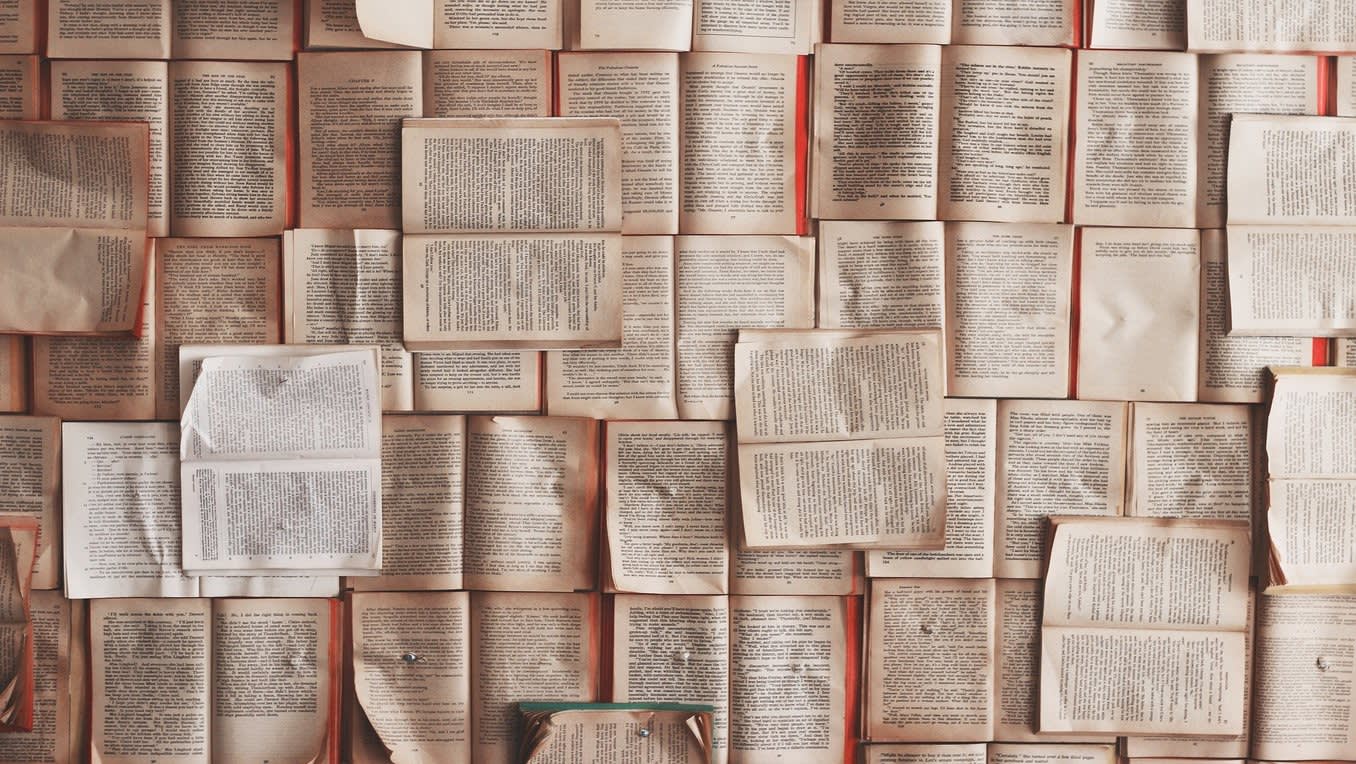Le titre de ce livre est emprunté au poème de Louis Aragon, et médiatisé par Jean Ferrat : pouvez-vous nous expliquer ce choix?
Parce que ce vers « Un jour viendra couleur d’orange » fait parfaitement
écho à la construction du livre (des chapitres qui portent tous des noms
de couleurs) et surtout, parce qu’il exprime une formidable et immense
espérance que je partage, même en ces temps sombres.
Quel lien unit l’enfance et le combat de ces hommes et de ces femmes, inspirés des gilets jaunes?
Dans les deux cas, l’enfance et le « combat », il y a l’espoir.
Au fond, pourquoi l’actualité sociale a-t-elle retenue votre attention?
L’époque est d’une très grande richesse complexe. Un régal pour un
écrivain. Écrire, c’est aussi porter un regard sur ce qu’on vit. C’est essayer de comprendre. C’est témoigner.
Comment marier émotion et problématiques sociales avec justesse?
Une problématique sociale, c’est avant tout une émotion. Celle de ne pas
se sentir respecté, par exemple. De se vivre du côté de l’injustice. Du
mépris. Du rejet. Tout cela sont des émotions humaines très fortes.
Quand on les écoute alors ce mariage se fait simplement. Et de façon très
évidente.
Dans quelle mesure raconter une histoire d’amour enfantine s’est-elle manifestée?
Tout s’est mis en place lors d’une délibération du jury du Prix Marcel
Pagnol dont je fais partie. Nous parlions des livres finalistes qui ont tous
pour point commun l’enfance et j’ai ce jour-là ressenti un besoin d’y
retourner. De renouer avec l’émerveillement. Au fond, on n’en a jamais
fini avec l’enfance.
Selon vous, pourquoi les gens, notamment dans votre livre, sont en colère?
Il y a deux grands types de colères. La colère sociale et la colère privée.
Pour la première elle vient du fait que le pacte tacite fait avec l’État et
que décrivait très bien Hobbes dans son Leviathan, n’est plus respecté.
On a renoncé à de la liberté contre de la sécurité et on s’aperçoit qu’on
n’a pas reçu cette sécurité promise. Alors la colère. Que je trouve
légitime. Ensuite, la colère privée. Souvent celle contre soi que l’on
retourne contre les autres. Dans mon livre, Pierre, le père de Geoffroy, va
profiter du bruit de la colère sociale des Gilets Jaunes pour crier ses
propres douleurs. On se cache souvent dans une meute.
Quel est le symbole de ces rassemblements, de ces manifestations?
Si l’on parle des Gilets Jaunes, il y a quelque chose d’émouvant à penser
que ce jaune fluo qu’ils portent évoque, la nuit, les lueurs qu’émettent les
lucioles. Elles le font non pas tant pour être vues que pour être retrouvées
par les autres. Leurs semblables. C’est là quelque chose d’essentiel. Se
retrouver. Être ensemble dans une même souffrance. Pour la partager.
L’alléger.
On croise aussi des thèmes forts comme le racisme systémique ou la peur de la différence (Geoffroy est atteint du syndrome d’Asperger) : quel était votre enjeu au moment de l’écriture?
Toujours mon besoin, pour ce texte, d’être en phase avec l’époque. Elle
est particulièrement complexe, on l’a dit. Morcelée. La différence effraie.
Elle engendre la violence, comme dans le cas de Geoffroy. Le racisme,
comme dans celui de son amie Djamilla. La colère, à cause des trop
nombreuses petites phrases minables des gouvernants.
Écrire, c’est aussi dénoncer. C’est-à-dire faire connaître. Car seule la
connaissance permet d’améliorer les choses.
Quel sentiment a guidé la rédaction de ce roman chez vous?
L’envie très profonde de rendre hommage à tous ceux qu’on bouscule.
Diriez-vous que votre écriture est devenue plus mordante, plus engagée au fil des livres?
Sans doute qu’avec le temps je dégraisse davantage. J’essaie d’aller à l’os
des mots. Quant à l’engagement, c’est le sujet qui commande. Mais oui,
dans une période suspecte, dangereuse même, de bien-pensance, je
continue à croire qu’un livre doit secouer. Cogner. C’est peut-être même
l’un des derniers lieux de liberté.
Si la colère se mêle à l’espérance, est-ce un roman utopique, au fond?
Sans doute. Ce sont les utopies qui ont dessiné le monde.
Au fond, le roman ne nous dit rien d’autre que nos problèmes peuvent d’abord être résolus par nous avant d’être résolus par les autres?
Il est faux de croire que les autres, et je pense à ceux qui nous dirigent,
vont régler nos problèmes. Il y a bien longtemps que la politique s’est
détournée de sa fonction. On a coupé la tête du Roi en 1793 mais pas
celle de la monarchie. Elle est là. Elle porte d’autres noms. D’autres
atours. Elle est une caste qui ne vit que pour sa survie. Il est temps de
reprendre notre pouvoir d’être heureux.
Voir son livre adapté en livre audio, quelle perspective ça lui donne?
C’est extraordinaire de penser qu’il va être lu à des personnes qui ne
peuvent pas lire. Qui n’ont pas toujours le temps de lire. Qu’il va
accompagner des heures durant des voyageurs. Des routiers. Des gardiens
de nuit. Il va être chuchoté. Il va être vivant.
Un coup de cœur livre à nous donner?
Du côté des indiens, d’Isabelle Carré (Grasset, 2020).
(Crédit photo : JF Paga)