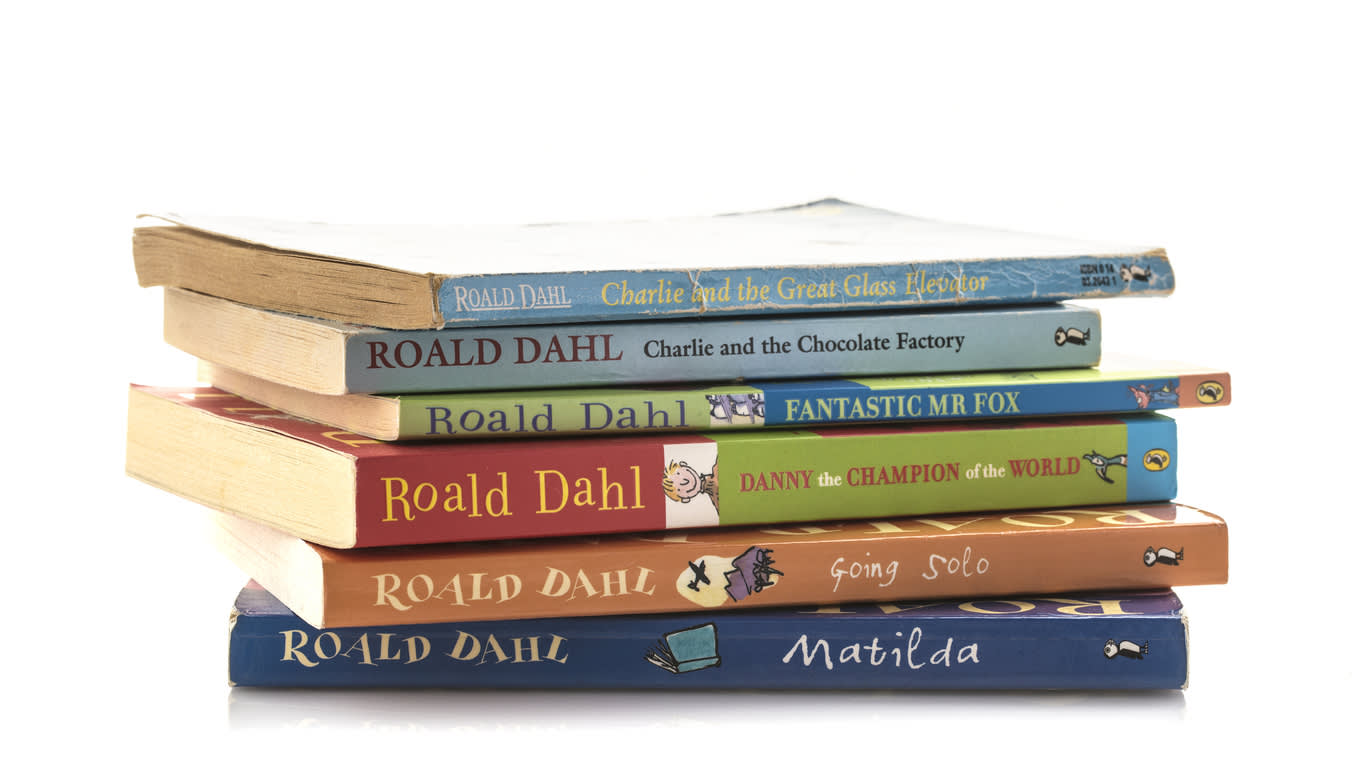Depuis plus de soixante ans, « Le Petit Nicolas » fait rire enfants et parents en France comme à l’étranger. Nées de l’imagination de René Goscinny et du trait de Jean-Jacques Sempé, ces histoires d’un petit garçon farceur, de ses copains, de son école et de ses parents se sont vendues à plus de 50 millions d’exemplaires, traduites en 45 langues. L’innocence du regard, l’ironie tendre et les dessins pleins de mouvement placent la série au premier rang de la littérature jeunesse française : un « classique » qui traverse les générations sans prendre une ride.
Le Petit Nicolas : genèse d’un chef-d’œuvre
Le duo Goscinny-Sempé
René Goscinny, futur père d’Astérix, et Jean-Jacques Sempé, future star du dessin de presse, se rencontrent à Paris en 1954. Entre la plume acérée du scénariste et le crayon aérien de l’illustrateur, la complicité est immédiate : ils inventent Nicolas, petit écolier candide mais aussi plein de malice, pour des pages humoristiques.
Des débuts belges à la publication française
Les premières chroniques paraissent en 1955 dans l’hebdomadaire belge « Le Moustique ». En 1959, Goscinny réécrit les textes « à hauteur d’enfant » pour « Sud-Ouest Dimanche » : succès fulgurant. Un an plus tard, Denoël publie le premier recueil, « Le Petit Nicolas ». Cinq volumes suivront du vivant des auteurs, puis des histoires inédites retrouvées dans les archives, publiées entre 2004 et 2009.
L’univers du Petit Nicolas
Dans la France des années 1950-1960, la cour de récré est encore une étendue de terre battue où résonnent les pas d’écoliers vêtus de blouses grises. Porte-plumes Sergent-Major entre les doigts, les enfants alignent pleins et déliés sous l’œil parfois sévère d’un instituteur en cravate. Pourtant, René Goscinny précise que « Nicolas vit dans un pays imaginaire où il fait toujours beau » : la reconstitution historique, très précise, n’est qu’un décor ensoleillé pour des gags intemporels sur les punitions, les parties de billes ou la grande fierté d’un devoir bien noté.
Tout est raconté par Nicolas lui-même, avec une syntaxe simple, une logique un brin bancale et un vocabulaire d’enfant (« c’est drôlement chouette », « on s’amuse bien »). Les préoccupations des adultes telles que la politique, l’argent ou encore le travail restent hors champ. À hauteur de pupitre, comptent surtout la peur d’être collé, l’envie furieuse de jouer et la solennité d’un goûter partagé entre copains. Cette naïveté sert un humour de connivence : le lecteur adulte perçoit en filigrane l’ironie douce-amère que Goscinny glisse derrière chaque tournure maladroite de ces enfants.
Enfin, l’univers du « Petit Nicolas » véhicule des valeurs simples, mais jamais mièvres. L’amitié prime, la solidarité de bande domine, mais la petite jalousie ou la mesquinerie ne sont jamais loin : Rufus se vante du sifflet de policier de son père, Agnan joue au chouchou, Eudes distribue les marrons. Goscinny et Sempé regardent ces travers avec bienveillance et transforme le miroir de l’enfance en miroir de la société tout entière : un reflet amusé plutôt qu’une leçon de morale, où chacun retrouve un fragment de ses propres cours de récré.
Les personnages inoubliables
Nicolas
Narrateur et héros espiègle, Nicolas observe le monde avec un mélange d’optimisme et de naïveté qui désamorce toutes les catastrophes. Sa bonne volonté permanente, « on voulait juste jouer », déclenche bêtises et punitions, mais jamais d’amertume : il incarne l’enfance dans sa version la plus généreuse et spontanée et traverse la vie avec une candeur désarmante, ce qui fait tout le charme de ces histoires.
Les copains
Autour de lui gravitent des silhouettes inoubliables : Alceste, toujours en train de manger ; Clotaire, irréductible dernier de la classe ; Agnan, chouchou binoclard que tout le monde veut taper sauf quand il pleure ; Eudes, poings prêts à distribuer des marrons ; Geoffroy, fils à papa couvert de gadgets ; Rufus, dont le sifflet de policier rétablit l’ordre… ou la pagaille. Portrait savoureux des relations entre copains à l'âge où se forgent les amitiés les plus sincères, ces archétypes de cour d’école font avancer la comédie par leur complémentarité et leurs chamailleries.
L’école
Dans la classe, la Maîtresse tente de garder son calme, le Directeur surgit pour faire un discours solennel, et surtout Le Bouillon (le surveillant aux yeux « dans le bouillon ») multiplie les « regardez-moi dans les yeux ! ». Autorité maladroite, parfois moquée, toujours dépassée, l’institution scolaire fournit le décor et les ressorts comiques des plus grandes scènes collectives.
La famille
À la maison, Papa, employé pressé, rumine ses soucis de voiture ou de costume, tandis que Maman arbitre les disputes et prépare le goûter avec une tendresse inébranlable. La Grand-mère, elle, prend le parti de son petit-fils contre les réprimandes paternelles. Leurs dialogues, entre conseils de sagesse et quiproquos domestiques, reflètent une France encore traditionnelle, mais déjà prête à sourire de ses propres travers.
Les filles
Dans cet univers de garçons surgissent parfois des héroïnes qui chamboulent l’équilibre : Marie-Edwige, voisine gracieuse à la corde à sauter ; Louisette, dribbleuse de foot qui ridiculise les garçons ; Isabelle, petite cousine à l’allure angélique, mais à la langue bien pendue. Entre premier trouble amoureux et rivalité résolument mixte, elles rappellent que l’enfance de Nicolas n’est pas qu’une affaire de billes et de bagarres.
Les adaptations : du livre à l’écran
Le Petit Nicolas – le film (Laurent Tirard, 2009)
Pour sa première incursion au cinéma, Nicolas prend vie sous les traits de Maxime Godart, entouré de Valérie Lemercier et Kad Merad dans les rôles des parents. Le réalisateur Laurent Tirard reconstitue une France début 1960 au cordeau : voitures rutilantes, blouses grises, mobilier d’époque. Si l’intrigue ajoute des péripéties inédites telles que la peur d’un petit frère à naître ou une fugue imaginaire, l’esprit d’origine demeure : humour bon enfant, langage d’écolier, illustrations de Sempé discrètement animées au générique. Avec plus de cinq millions d’entrées, le film installe Nicolas comme héros de grand écran sans trahir la tendresse des livres.
Les Vacances du Petit Nicolas (Laurent Tirard, 2014)
Quatre ans plus tard, la même équipe embarque Nicolas pour des vacances mémorables à Noirmoutier. Plage, hôtel de bord de mer, nouveaux copains et premiers émois amoureux composent un pastiche d'aventures estivales. Tirard modernise légèrement les gags, dynamise le rythme, mais conserve décors rétro et tonalité familiale. Les critiques saluent une fidélité d'atmosphère tandis que lecteurs comme néophytes y retrouvent la saveur des chapitres "Vacances" du recueil original.
Les séries d’animation (1999, 2009, 2021)
Trois productions télévisuelles ont successivement adapté l'univers imaginé par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Leur point commun : un graphisme fidèle au trait minimaliste et aux couleurs franches du dessinateur parisien, et des scénarios souvent tirés mot pour mot des histoires originales. La version 2009, coproduite par France 3, aligne 104 épisodes de 12 minutes, diffusés dans le monde entier. Pour beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, ces séries d'animation sont la porte d'entrée vers les histoires papier, tant la proximité avec le texte est grande.
Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? (Amandine Fredon & Benjamin Massoubre, 2022)
Mi-documentaire, mi-animation, ce long-métrage lauréat du Cristal d'Or à Annecy imagine un dialogue rêveur entre Sempé, Goscinny et leur créature. Les auteurs apparaissent en personnages dessinés, évoquant leur amitié et le processus de création, tandis que des séquences des albums s'animent sous nos yeux. Le résultat est un hommage sensible : archives audio de René Goscinny, musique jazzy, tendresse absolue pour le petit personnage qu'ils ont créé. Plus qu'une adaptation, c'est une déclaration d'amour qui célèbre à la fois les créateurs et l'enfant espiègle qu'ils ont légué à la culture française.
L’héritage et l’impact culturel
Littérature jeunesse : avant Nicolas, peu de récits adoptaient la voix enfantine avec une telle justesse. De Tom-Tom et Nana à Mortelle Adèle, la filiation est assumée.
Patrimoine français : citations au Brevet, dictées, planches de Sempé exposées à Orsay. Nicolas incarne une part d’enfance nationale, comme La Comtesse de Ségur au XIXᵉ siècle. Les habitants de Paris reconnaissent dans ces pages un portrait fidèle, bien qu'idéalisé, de leur ville à une époque révolue.
Réception internationale : best-seller en Allemagne, Italie, Japon, « Le Petit Nicolas » est même étudié dans les écoles québécoises pour le français langue seconde.
Programmes scolaires : chapitres extraits (La Rentrée, Le Football) illustrent l’autobiographie romancée et l’humour de situation. Les textes peuvent être utilisés pour initier les enfants à la lecture dès la classe de CE2.
Recommandations : comment (re)lire Le Petit Nicolas ?
Besoin du lecteur | Recueil à choisir | Pourquoi |
Découvrir l’univers | « Le Petit Nicolas » (1960) | Premières scènes, présentation de tous les copains |
Chercher l’été | « Les Vacances du Petit Nicolas » (1962) | Campagne, plage, gags en maillot |
Rire en famille | « Le Petit Nicolas et les copains » (1963) | Dialogues savoureux, parties de foot, disputes |
Explorer des textes moins connus | « Histoires inédites du Petit Nicolas » (2004-2009) | Trésor d’archives exhumé, 80 nouvelles jamais publiées |
Fan de Sempé | Version audio-illustrée ou BD animée | Dessins commentés, ambiance sonore années 60 |
FAQ : Le Petit Nicolas
Dans quel ordre lire les recueils ?
Essayez de les lire dans l’ordre de parution historique : « Le Petit Nicolas », « Les Récrés du Petit Nicolas », « Les Vacances… », « Le Petit Nicolas et les copains », « Le Petit Nicolas a des ennuis ». Les tomes « inédits » peuvent se lire ensuite, librement.
À partir de quel âge ?
Dès 8 ans en lecture accompagnée ; à 10-11 ans en lecture autonome. L’humour à double niveau permet aux adultes de se régaler aussi.
Quel rôle joue l’illustration ?
Le trait de Sempé accentue l’ironie : maigres jambes qui s’emmêlent, maîtresse débordée, papa bougon. Il offre un contrepoint visuel parfait à la vivacité du texte.
Pourquoi Nicolas est-il souvent puni ?
Parce qu’il transgresse involontairement les règles d’adulte ; la punition devient moteur narratif et rebond comique, jamais humiliation.
Rien n’a vieilli dans Le Petit Nicolas : ni sa langue vive, ni ses insolentes parties de billes, ni la douceur goguenarde de ses parents. Qu’on relise les textes d’origine, qu’on découvre les histoires inédites en audio sur Audible ou qu’on regarde le film de 2009 sous la couette, on retrouve ce parfum rare : celui de l’enfance – espiègle, libre, délicieusement universelle.