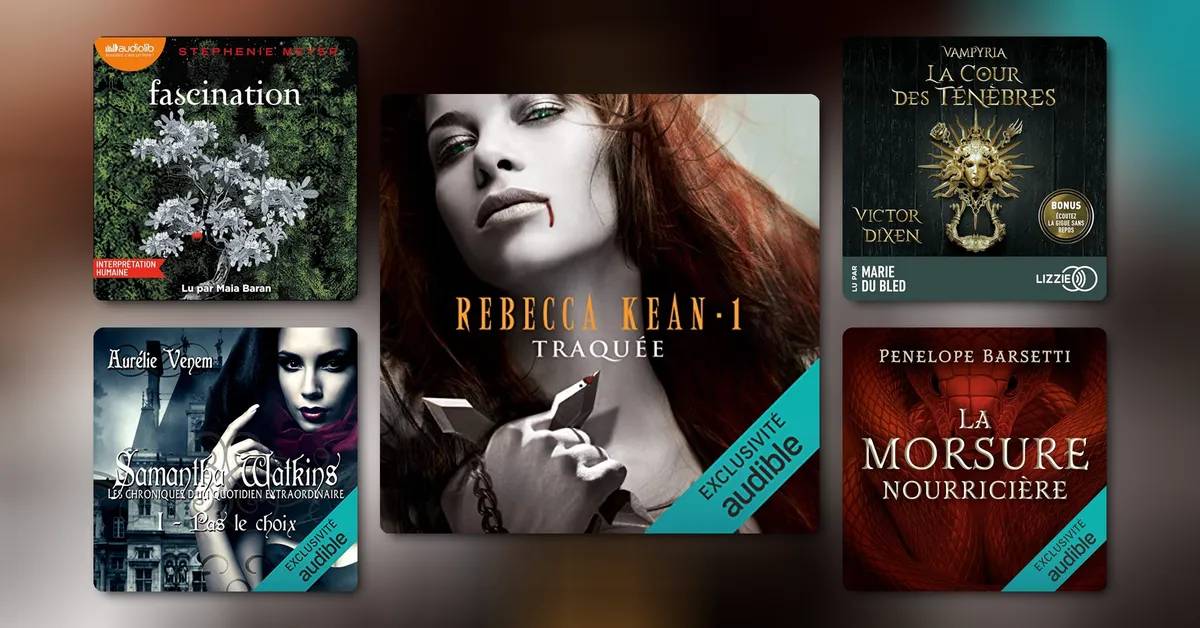Dans le livre, Cléo est racontée sur trente ans par les gens qu’elle a croisée. En tant que romancière, pour quelle raison ne suivons-nous pas cette histoire du même poste d’observation ?
Pour plusieurs raisons. C’est quelque chose qui était évident à la naissance du roman. Je savais peu de choses, mais je savais que le personnage central serait raconté par les autres. Cléo perd le récit d’elle-même à 13 ans et ne peut le faire, il y avait un éclatement en puzzle. Il serait artificiel qu’elle puisse le raconter, car elle a des trous dans cette histoire. Je trouvais que la façon la plus juste était de la raconter par les gens qui ne perçoivent qu’un reflet de nous.
Quelle est l’importance de la classe sociale dans l’art de dire les choses ici ?
C’est une arme. Le langage est une arme, à partir du moment où Cléo, Betty, et toutes les autres viennent d’une classe intermédiaire, qui n’est pas précaire. Il y a évidemment, dans la prédation, la domination. Et on peut dominer par la langue, on peut dominer par le bagage culturel. C’est facile d’impressionner quelqu’un de 13 ans qui n’a jamais mis les pieds dans un musée.
Est-ce qu’il y a des choses qui vous ont échappé au moment de l’écriture ?
Tout le temps. Toujours. La question est de savoir quand est-ce que je me laisse emporter par ce que je vois qui va survenir et qui n’est pas ce que j’avais pensé. Par exemple, le personnage de Jonas, où, finalement, le père a pris plus d’importance que ce que j’imaginais. Il est bizarrement devenu quelqu’un de très cher à mon cœur.
Vous jugez vos personnages en tant que romancière ?
Je mentirais si je disais que je ne jugeais pas ce qu’est une prédatrice avec sa mise en scène affective. Mais mon jugement n’est pas intéressant, ce qui est intéressant, c’est que je la donne à voir, que je décortique le langage de la prédation, la manière dont ça se passe. J’évite de mettre ce que j’en pense dans les romans.
Dans cette danse dont il est question dans Chavirer, le corps est primordial. Quel est vous, votre rapport au corps, comme outil narratif ?
Mon rapport au corps est sans doute un peu plus compliqué que celui des autres auteur.e.s, car j’ai été danseuse. Je ne suis pas une autrice qui a fait un parcours littéraire, le mien a été très physique. Que ça soit les voyages, la danse, un certain engagement politique, qui était aussi physique. Je pense que le corps est à la fois un outil dans ce que ça a de plus ambivalent (qu’on peut utiliser jusqu’à la maltraitance), mais aussi quelque chose que l’on observe. Mes rituels d’écriture passent par le corps, j’ai besoin d’écrire au réveil. J’aime l’état semi-embrumé, semi-lucide. Il y a un vrai rapport entre la danse et l’écriture pour ce qui est de la tenue du corps. Je ne pourrais pas écrire allongée dans un canapé, j’ai besoin d’être très droite, à l’affut physiquement, pour écrire.
En lien avec le roman, diriez-vous que le corps d'une femme est perpétuellement évalué, déterminé, même ? Et comment être soi à travers toutes ces injonctions, tous ces avis ?
Je ne sais pas, et c’est bien ça le problème. C’est ce à quoi on est confronté. On essaie de se trouver une petite route. Mais oui, bien sûr, le corps d’une femme est tout le temps estimé. J’ai l’impression que plus je vieillis, plus je m’en rends compte. Une fois que le corps est jugé désirable, on passe très vite à la date de péremption. Il y a vraiment quelque chose de non-stop. L’écriture est aussi une liberté pour ça : on est seule, on créé un monde quand on est une femme. C’est un geste puissant d’écrire, pour une femme.
On a besoin de la fiction aujourd’hui ?
Bien sûr, la fiction est le seul espace que je vois où on peut exprimer du doute et de l’ambiguité. Le discours politique est complètement hermétique au doute. La fiction est l’espace pour exprimer la complexité et pour s'interroger sur des choses qui seraient peut-être rebutantes. Le personnage de Cléo est ici lisible. Dans un fait divers, peut-être que cette histoire n’aurait pas du tout la même portée.
Il est aussi question de la manière dont on sait se pardonner ici aussi. Ca s’apprend, le pardon ?
Le pardon, on ne peut pas l’accorder. Il faut que la personne qui vous a offensé.e vienne vous demander pardon. Pour moi, la question est vraiment ce qu’on peut « se » pardonner ou pas; la majorité de nos vies se passent quand même à être entravé.e parce qu’on en se pardonne pas. Par des gestes, par des moments qu’on n’a pas bien fait. Qu’est-ce qu’on peut s’accorder à soi-même comme pardon ? On est tous et toutes hanté.e par des moments où l'on n'a pas fait le bon geste, pas dit la bonne phrase. Tous les personnages de Chavirer ratent quelque chose avec Cléo. Tous.
(Crédit photo : Lynn SK)