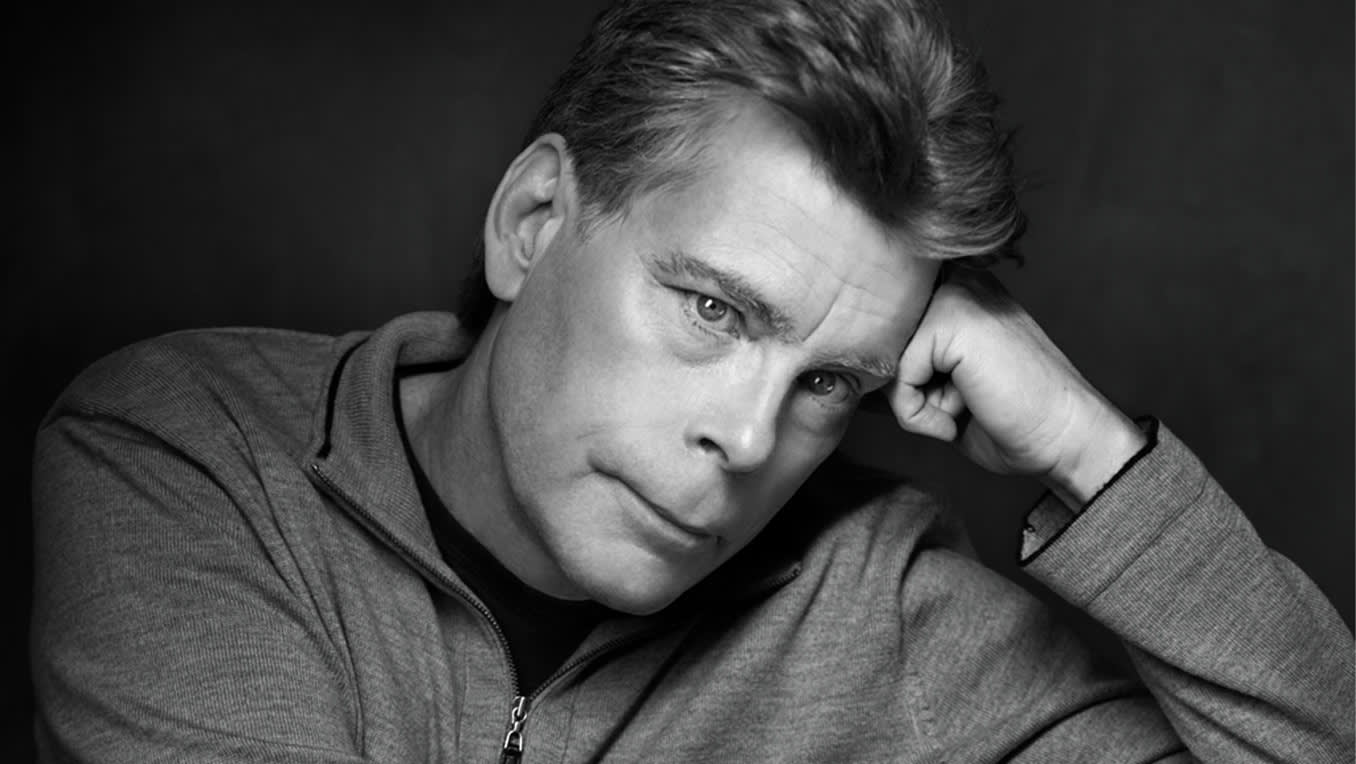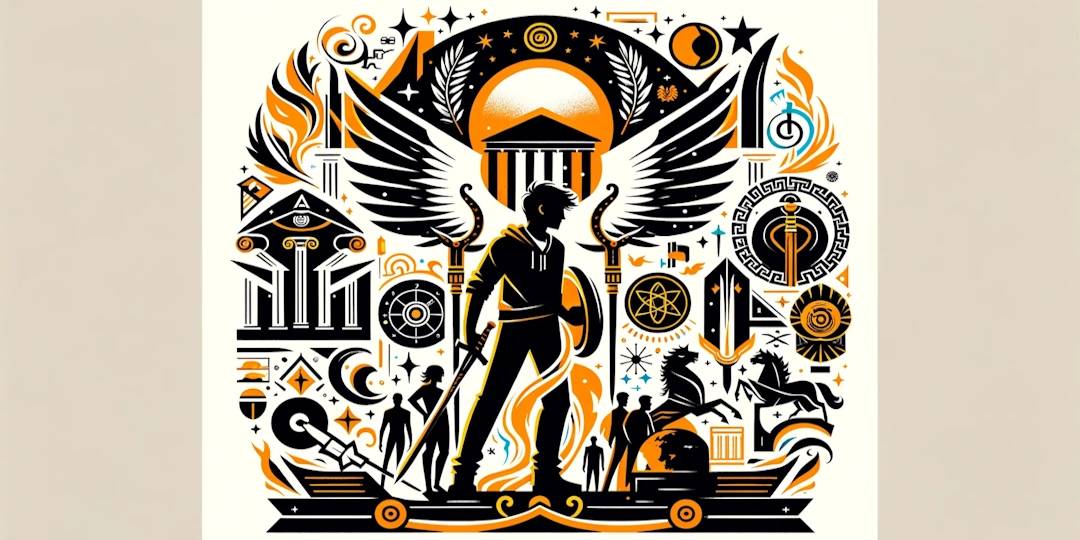Dans L’art de perdre, vous interrogiez le passé et ici, l’action est fondamentalement ancrée dans l’actualité. Qu’est-ce que ça implique au moment de l’écriture, d’écrire sur le présent ?
Ça implique de se laisser surprendre, ou du moins emporter dans de nouvelles directions au fur et à mesure des événements. Ça implique de ne pas écrire en palimpseste, c’est-à-dire à sur des couches de langages qui se seraient sédimentées les unes sur les autres au fil du temps, mais d’essayer de produire sa propre matière première.
Comment avez-vous fait vos recherches pour l’écriture de ce roman ?
En alternant les lectures, les visionnages de documentaires et les voyages – un peu comme d’habitude, au fond. Sauf que les sujets et les destinations changent à chaque fois... Ce n’est pas la même chose d’aller à une conférence de hackers à Las Vegas et de traverser la Méditerranée en bateau pour atteindre Alger.
L. incarne le « Hacktivisme », qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que ça dit de notre société ?
C’est la contraction de « hacker » et d’ « activisme », donc des militants ou des militantes qui utilisent le piratage à des fins politiques, comme les Anonymous, Lulzsec ou Phineas Fisher ont pu le faire. Je ne sais pas ce que le hacktivisme en soi dit de notre société. Ce que je trouve incroyable c’est le silence relatif qui l’entoure, comme si ce qui se passait sur le terrain informatique était coupé du reste du monde, se produisait dans un univers parallèle. J’aurais voulu qu’on me raconte des histoires de hacktivistes pendant que je grandissais, ça m’aurait paru plus intéressant que les fonctionnalités des tableaux Excel et je serais sans aucun doute plus agile avec les ordinateurs.
Diriez-vous que c’est un roman sur les formes d’engagements que « permet » notre société aujourd’hui ?
Oui, c’est une sorte de traversée de différents paysages politiques : l’institution, la désobéissance, le repli sur le collectif… Aucune de ces formes n’est parfaite et les personnages ont comme point commun de toujours se demander s’ils ont eu raison de s’engager dans cette voie-là. Ils ont aussi en partage une nostalgie d’un temps plus ou moins lointain où l’engagement leur paraissait plus simple et plus flamboyant : la Guerre d’Espagne pour Antoine, les premières actions d’Anonymous pour L.
On voit, et c’est effrayant, que les données qu'on laisse çà et là sur internet appartiennent à tout le monde sauf à nous. Quelles ont été vos pistes de réflexion exactes ?
Plus j’avançais dans mes recherches, plus je m’étonnais de voir avec quelle désinvolture la plupart des gens traitent le vol et le recel de leurs données. Parvenir à penser ses droits numériques et ses
libertés fondamentales en ligne est encore compliqué, ce qui permet aux GAFAM d’utiliser et de revendre un nombre ahurissant d’informations sur nous sans que nous nous pensions lésés ou même véritablement surveillés. Pourtant, plus la technologie se développe, plus nous développons aussi une identité numérique, au sens où nous multiplions les actions, contacts, démarches que nous n’effectuons plus qu’en ligne mais cet être-là, nous ne savons pas bien quelles sont ses frontières, comment le défendre, quels sont ses droits inaliénables... Avec le personnage de L, je voulais créer une femme qui soit consciente des dangers du « dedans » comme du « dehors », qui voit la menace dans les deux mondes qu’elle arpente et qui doive donc être en permanence aux aguets, sur le qui-vive. L ne connaît pas le repos.
Avec internet, il y a des dérives, mais il y a aussi des conséquences positives. L. le voit également comme un espace où on peut s’échapper aux déterminismes de l’extérieur, avoir plus de liberté, aussi. Est-ce que c’est vraiment le cas ?
Oui. Et je crois qu’il est crucial qu’Internet soit défendu au nom de ces possibilités. Ce que pourrait être cet espace, s’il n’était pas abandonné aux plus riches et aux plus forts, est absolument magique. La pensée de l’open source, du partage, du bien commun offert au bricolage doit être maintenue contre toutes les dérives que l’on connaît aujourd’hui. Et d’ailleurs, vous pouvez voir qu’aux Etats-Unis, les plateformes progressistes comme BrandNewCongress et JusticeDemocrats ont intégré ces problématiques à leur charte : les candidats qu’elles soutiennent s’engagent par exemple à se battre pour la neutralité du Net et à gracier Chelsea Manning.
Quel rapport vous entretenez, vous, avec internet ?
Le même qu’avec les océans. Je sais que je n’en connais qu’une infime partie (et en plus je la connais mal) et la pensée de ce qui s’étend au-delà de mes connaissances me fascine et m’effraie.
Vos personnages « font » tous de la politique d’une manière différente. Mais vous, aviez-vous l’envie de faire un roman politique ? Et de faire de la littérature un outil politique ?
Faire un roman politique, ce n’est pas la même chose que de faire de la littérature un outil politique. Un roman politique, c’est un roman qui s’interroge sur ce que lie les personnages entre eux mais aussi aux différentes composantes de la société à laquelle ils/elles appartiennent, sur ce que ses liens et organisations inspirent aux personnages : de l’espoir, du contentement, du dégoût, de la colère, etc. Les romans que je préfère sont ceux qui prennent le temps de traiter ces sujets. Ils ne deviennent pas des outils politiques, ils ne sont mis au service de rien d’autre que d’eux-mêmes : le politique est profondément romanesque et la littérature est une excellente manière de le traiter.
Quelle nouvelle perspective le livre audio peut-il donner à votre roman ?
J’aime imaginer que le roman pourra être écouté dans des situations si variées que je ne peux pas les imaginer – alors que la lecture implique un certain nombre de contraintes physiques qui font que, grosso-modo, tous les lecteurs et les lectrices se ressemblent dans l’action de lire.
Pour finir, avez-vous un coup de cœur livre à nous partager ?
Ce deuxième confinement m’obligeant de nouveau à une mobilité réduite, je repense souvent à Par les routes de Sylvain Prudhomme qui est un roman merveilleux sur l’amour, l’auto-stop, la traduction, les ellipses et les pâtes à l’ail.
(Crédit photo : Astrid di Crollalanza)